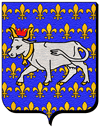|
||
 |
||
Signification des armoiries |
||
|
SIGNIFICATION des armoiries. On a beaucoup écrit sur la signification des armoiries ; mais, à l'exception de quelques cas isolés, le défaut de documents certains n'a jamais permis de résoudre définitivement le problème. Pour déterminer le sens des figures héraldiques, il serait indispensable d'en connaître l'origine : or, c'est précisément ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne saura vraisemblablement jamais ; car les traditions que possèdent sur ce point la plupart des familles ne présentent presque jamais un caractère suffisant de certitude. « En général, dit un éminent écrivain, il y a peu d'armoiries dont l'origine et la signification précises soient bien connues. La plupart des maisons ont du moins cherché à rattacher les leurs à des aventures étranges, romanesques et peu prouvées, que les hérauts ont répandues sur des données qui n'existent plus. » L'absence de textes positifs n'a pas empêché les héraldistes d'autrefois d'entreprendre de tout expliquer, et la fécondité de leur imagination a produit divers systèmes, où, à côté de quelques faits vrais ou vraisemblables, se trouvent une multitude d'assertions parfois ingénieuses, mais presque toujours très-hasardées, si elles ne sont pas absolument fausses. En ce qui concerne les pièces honorables, les uns croient qu'elles représentent le costume de guerre des anciens chevaliers, et voient le casque dans le chef, la lance dans le pal, le baudrier dans la barre et la bande, le ceinturon dans la fasce, les éperons et les bottes dans le chevron, l'épée dans la croix, le sautoir et la cotte d'armes dans l'orle et la bordure. Les autres prétendent que les pals, les chevrons, les sautoirs, les jumelles, les tierces, etc., figurent différentes parties des lices ou barrières que l'on élevait à l'occasion des tournois, et que les fasces et les bandes symbolisent les écharpes que les combattants portaient dans ces solennités. Ces opinions, et plusieurs autres qu'il serait inutile de rapporter paraissent ne reposer sur aucune base certaine, et on peut sans, craindre de trop s'aventurer, les reléguer au rang des fables. Tout ce qu'il est peut-être permis d'admettre, c'est que les pièces honorables représentant des figures d'une construction très simple, ont dû, en raison même de leur facilité d'exécution, être adoptées, comme signes de reconnaissance, dès l'origine même de l'art héraldique ; ce sont celles, en effet, que l'on rencontre dans les armoiries des plus anciennes familles. Toutefois, l'une d'elles, la Croix, passe généralement pour avoir pris naissance aux Croisades ; mais il ne faut pas oublier que si ces grandes expéditions ont donné à l'emploi de cette figure un développement inconnu auparavant, il serait peu logique de considérer comme ayant compté un de leurs ancêtres dans les guerres d'outre-mer tous ceux dont l'écu porte le signe de la Rédemption, parce que la piété de nos pères a dû plus d'une fois suffire pour faire adopter, comme pièce héraldique, l'instrument du supplice du Christ. Les Besants et les Croissants passent également pour dater des Croisades. Les premiers offrent, assure-t-on, l'image d'une des principales monnaies en cours dans l'empire grec. Mais nous verrons bientôt, par l'exemple de la famille dauphinoise de Poitiers, qu'ils peuvent n'être aussi que d'autres figures circulaires dénaturées. Quant aux seconds, leur introduction dans les armoiries semble remonter à une époque relativement moderne, car les populations de l'Europe occidentale n'ont commencé qu'assez tard à les donner pour emblème aux nations musulmanes. Enfin, les Coquilles, si elles n'indiquent pas toujours une participation plus ou moins directe aux guerres saintes, dénotent au moins que le premier qui les a fait peindre sur son écu avait figuré dans un de ces pèlerinages, moitié pacifiques, moitié militaires, si fréquents au moyen âge et qui n'avaient pas toujours pour but le Saint-Sépulcre. Parmi les figures, soit naturelles, soit artificielles, qui meublent les écus, il en est sans doute beaucoup qui appartiennent au domaine de la fantaisie, mais le hasard n'a pas dû toujours présider au choix du plus grand nombre ; malheureusement les textes qui pourraient nous apprendre la cause qui les a fait adopter, ou sont perdus depuis longtemps, ou sont arrivés jusqu'à nous dans un si grand état d'altération évidente, qu'il n'est guère possible de les prendre au sérieux. Beaucoup de figures ont été choisies à cause de la ressemblance de leur nom avec celui de la personne. Les armoiries où les figures de cette sorte se rencontrent sont des armoiries parlantes, ou armes qui chantent, comme quelques-uns les appellent, et le nombre en est énorme. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, Hérisson (Bretagne) portait : D'argent, à 3 hérissons de sable ; — Barillon (Poitou) : De gueules, à 3 barillets d'or cerclés de sable ;— Le Boeuf (Normandie) : D'or, au boeuf de gueules ; — Bouvier (Normandie): D'argent, au rencontre de boeuf de sable, accorné d'or, au chef de sable ; — Des Hayes (Maine) : D'azur, à 3 haies d'or ; — Trois-Monts (Normandie) : D'azur, à 3 montagnes d'argent ; — Loyseau (Île-de-France) : De gueules, à un oiseau d'or perché sur un écot du même ; — Maigne (Guyenne) : D'azur, à une main appaumée d'argent ; — Sesmaisons (Bretagne) : de gueules, à 3 maisons d'or, ouvertes, ajourées et maçonnées de sable ; — Sauvage (Languedoc) : d'azur, au sauvage de carnation, ceint et couronné de feuilles de sinople, tenant de sa main droite une hallebarde du même mise en pal ; — La Tour d'Auvergne : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la tour d'argent maçonnée de sable, brochante ; — Jean Racine : D'azur, au cygne d'argent membré et bccqué de gueules ; — Charles du Fresne, sieur de Ducange : D'or, au fresne de sinople, etc. Les armes primitives de la maison de Poitiers, en Dauphiné, appartenaient à la même catégorie, mais elles constituaient, en outre, un véritable rébus : on y voyait six pois ; mis en tiers, c'est-à-dire posés 3, 2 et 1, dont on fit plus tard des besants. Les anoblis prenaient souvent des armes parlantes, et, dans ce cas, ils les composaient assez fréquemment de figures qui rappelaient leur ancienne profession. C'est pour ce motif que les Médicis, de Florence, paraissent avoir pris pour armes des pilules, qu'ils transformèrent plus tard en tourteaux, afin de faire oublier l'humble point de départ de leur maison. Les gentilshommes attachés au service des princes semblent avoir suivi le même exemple, et il est probable que la plupart des fleurs de lis portées en armoiries par tant de familles françaises, sont moins des concessions particulières que des marques d'offices remplies par quelques-uns de leurs membres à la cour de nos rois (1). Quelquefois les armoiries formaient une anagramme. Telles étaient, entre autres, celles de la maison de Lorraine : — D'or, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, — alérion étant l'anagramme de Lorraine (2). Il n'était pas rare aussi qu'elles tirassent leur origine d'une anecdote ou d'un fait particulier à celui qui les avait adoptées le premier. Les princes d'Orange, par exemple, portaient : D'or, au cornet d'azur, — à cause de Guillaume d'Orange dit au cort nez. La Roque rapporte que Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, prit pour armes : — De gueules, au léopard d'or, — parce que le léopard est bâtard, puisque, au dire de Pline l'Ancien, il résulte des relations d'une panthère mâle et d'une lionne. Des chroniqueurs racontent que l'empereur Frédéric ier, ayant donné un lion à Ladislas ii, roi de Bohême, qui portait alors un aigle, l'artiste chargé de représenter le noble animal lui fit la queue si courte que les soldats prétendirent que c'était un singe, ce qui obligea le prince bohémien à lui faire peindre deux queues dressées et passées en sautoir afin qu'on pût bien les apercevoir. Les armoiries des Colonna, de Rome, ont une origine assez compliquée. Un membre de la famille, le cardinal Jean, ayant été envoyé en Palestine, en qualité de légat, en rapporta, vers 1223, un tronçon de la colonne qui avait, dit-on, servi à la flagellation de Jésus-Christ. Pour perpétuer le souvenir de cet événement, il prit le nom de Colonna, qui est resté à sa maison, et adopta pour armes : D'azur, à une colonne d'argent. Plus tard, les Colonna surmontèrent cette colonne d'une couronne royale, quand Étienne Colonna eut couronné Louis de Bavière empereur. Enfin, au xvie siècle, ils ajoutèrent quatorze guidons turcs aux figures précédentes, parce que Marc-Antoine Colonna avait commandé les troupes pontificales à la bataille de Lépante. À propos des armes des Colonna, citons celles des Orso. Cette famille portait primitivement un ours, mais le cardinal Julien Cesarini, un de ses membres, favori du pape Martin v (Othon Colonna), enchaîna l'animal à la colonne du souverain pontife, son bienfaiteur, et, plus tard, un descendant de ce prince de l'Église obtint de Charles-Quint l'autorisation de prendre l'aigle impériale. Par suite de ces différentes additions, la maison se trouva porter : D'or, à l'ours de sable, attaché par une chaîne d'argent à une colonne d'azur couronnée de gueules, à l'aigle impériale mise en chef. Des idées symboliques paraissent avoir été attachées à certaines armoiries, mais il est bien difficile d'obtenir sur ce point des résultats positifs, et, une fois lancé dans la voie des interprétations, on peut aller très loin, pour peu qu'on ait l'imagination ardente. Suivant les anciens héraldistes, et en nous bornant aux figures empruntées à l'histoire naturelle, — l'Aigle signifierait la domination ; le Vautour, la hardiesse ; le Perroquet, l'éloquence ; la Colombe, l'amour conjugal ; le Corbeau, la médisance et la dissension ; le Coq, de même que le Héron et la Grue, la vigilance ; le Cygne, une vieillesse très avancée, etc. ; enfin, le pélican, qui, selon les anciens Bestiaires, se déchire le sein pour nourrir ses petits, serait l'emblème du dévouement, et du dévouement le plus absolu. On attachait aussi une signification particulière
aux figures tirées du règne végétal. Les fleurs
passaient pour symboliser toutes l'espérance,
parce que leur apparition au printemps fait,
disait-on, présager les récoltes de l'automne. De
plus, la Rose figurait la grâce et la beauté. Quant
à la fleur de Lis, que les rois de France choisirent
pour orner le champ d'azur de leur écu, et que
l'on représentait avec trois pétales seulement, « il est hors de doute, dit un de nos plus spirituels
écrivains, que le pétale central représentait
la religion, et que les ailes ou feuilles latérales
étaient la force morale et la force matérielle destinées à lui servir d'appui (3). » Parmi les arbres, le Chêne signifiait la puissance ; la Vigne, l'allégresse ; l'Olivier, la paix ; le Cyprès, la tristesse ; le Pommier, l'amour ; le Figuier, la douceur des moeurs et la tranquillité de la vie, etc. Les Gerbes et les Épis symbolisaient la frugalité et l'abondance. Enfin, on trouvait dans la Grenade l'expression emblématique de l'alliance des peuples réunis sous une même religion. Mais des idées symboliques n'ont pas été seulement rattachées aux figures : on a cherché un sens analogue à chacun des principaux émaux. Il suffira de citer à ce sujet un passage du père Anselme : « L'or, dit cet héraldiste, signifie des vertus chrestiennes, la foy, la justice, la charité et l'humilité, et des qualitez et vertus mondaines, scavoir, la force, la prospérité, la constance et les richesses. — L'argent, entre les vertus chrestiennes, signifie la pureté, l'espérance, la vérité et l'innocence, et des qualitez mondaines, la beauté, la gentillesse, la franchise et la blancheur. — L'asur signifie la chasteté, loyauté, fidélité et bonne réputation, — et le gueules dénote amour, vaillance, hardiesse et générosité. — Le sable signifie prudence, sagesse, et constance aux adversités et dans la tristesse, — et le sinople, civilité, amour, joye et abondance. — Le pourpre dénote la dévotion, la tempérance, la libéralité et l'autorité souveraine. — L'hermine est symbole de pureté. » Le savant écrivain ne donne pas la signification des autres émaux, mais il prétend que le vair a été introduit dans les armoiries pendant les Croisades par un membre de la maison de Coucy (4). d'après l'Abrégé méthodique de la science des armoiries
W. Maigne — Paris, 1885 SIGNIFICATION. Que signifient ces armoiries ? C'est la première question que pose une personne étrangère à la science héraldique. Rien est l'unique réponse possible. Le blason n'est point une langue, comme on le croit généralement par une erreur grossière. Lorsque les chevaliers du moyen-âge eurent adopté l'usage de peindre des figures sur leurs boucliers, les premiers hérauts d'armes dictèrent des lois, donnèrent des préceptes pour la manière de diviser l'écu, d'y coordonner les émaux et d'y placer les pièces. Ils employèrent alors le langage du temps, et leurs successeurs conservèrent les expressions dont ils s'étaient servis et qui en vieillissant ont cessé d'être en usage. La langue française, en matière de blason, est restée stationnaire comme le costume du clergé et de la magistrature. Elle est devenue technique, et le vulgaire n'en comprenant plus le sens et l'origine, s'est cru en présence d'une langue hiéroglyphique. L'ignorance a propagé cette opinion et causé souvent les méprises, les inadvertances les plus ridicules, qui se sont glissées jusque dans les travaux les plus sérieux. d'après l'Annuaire de la noblesse de France
André Borel d'Hauterive — Paris, 1868
Notes de l'auteur
|
||
|
|
||
|
||
|
|
| Plan du site Mises à jour Liens |
Identification d'un blason |
Certains meubles utilisés sont sous licence Wikimedia Commons